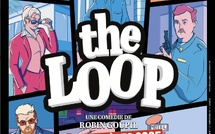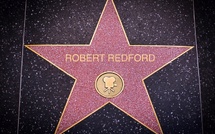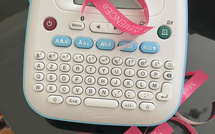Par quoi l’histoire de À feu doux vous a-t-elle été inspirée ?
À feu doux est né d’expériences à la fois personnelles et professionnelles. La première inspiration vient de la relation avec ma grand-mère qui, alors que j’étais adolescente, s’est retrouvée atteinte de démence.
Alors qu’elle avait été éditrice de poésie et que son identité s’exprimait beaucoup à travers le langage, elle a cessé de parler. Lorsque cela s’est produit, sous le coup du trouble et du chagrin, ma famille s’est mise à parler d’elle comme si elle n’était plus là. Cette manière de parler de quelqu’un qui perd la mémoire est extrêmement courante.
Pourtant, quand je lui rendais visite, je la trouvais très expressive sur le plan physique. Elle se balançait, elle tapait des rythmes avec ses mains : il me semblait clair que, même si sa cognition était modifiée, cette autre partie d’elle-même s’exprimait.
Le fossé entre cette personne qui était bien là, juste d’une manière différente, et la façon dont le langage la décrivait est une idée qui m’a longtemps hantée.
Quelle est l’expérience professionnelle qui est venue compléter ce souvenir ?
Dix ans plus tard, alors que j’enchaînais les boulots d’assistante sur des tournages à New York, j’ai eu l’impression d’en avoir fait le tour.
J’ai alors arrêté la production, et ai commencé à travailler en tant qu’assistante pour un sculpteur atteint de démence, puis pendant plus de trois ans, pour d’autres artistes new yorkais en proie à des troubles de la mémoire.
Ce travail a changé tout ce que je pensais savoir sur le vieillissement et le soin, en particulier sur l’identité liée à l’âge. J’avais une vingtaine d’années à l’époque et les personnes que j’assistais avaient beau être octogénaires et nonagénaires, elles s’identifiaient à moi comme à leur véritable pair, non pas comme à quelqu’un de plus jeune.
Cette perception malléable de l’âge et de l’identité est ce qui a conduit aux prémices de À feu doux : j’avais envie de faire de Ruth un personnage à la fois sans âge et de tous les âges, et d’explorer toutes ses itérations possibles.
Une partie du film a été réalisée avec les résidents d’un établissement. Comment est né ce processus ?
Après avoir travaillé comme aide-soignante, j’ai réalisé un court-métrage (Home Exercises) en collaboration avec un groupe de personnes âgées. J’ai remarqué qu’elles étaient très intéressées par la réalisation -elles ne se contentaient pas de jouer dans le film, elles voulaient comprendre la cinématographie, le son, la production.
Avec mon équipe, nous avons fini par leur apprendre en quoi consistait la réalisation d’un film. J’ai compris que si je voulais vraiment faire un film contre l’âgisme, mes méthodes devaient refléter l’éthique du projet.
La société américaine pense à tort que les personnes dépendantes de soins n’ont plus rien à apporter, j’ai donc voulu intégrer leurs talents à la réalisation du film.
Quelle forme a pris cette collaboration ?
Trouver la bonne communauté a pris un certain temps : nous avions besoin d’un endroit sensible à l’idée d’apprentissage et capable d’accueillir la production d’un long-métrage.
Villa Gardens a été fondée dans les années 1920 par Ethel Percy Andrus, la toute première femme proviseure de Californie et fondatrice de l’AARP (American Association of Retired Persons).
Aujourd’hui, la communauté reste formée d’anciens professionnels de l’éducation. Il y règne une vraie culture de l’apprentissage : le fait que les résidents veuillent découvrir comment faire des films était nécessaire à la réalisation du projet.
Nous avons organisé un atelier de cinq semaines autour de l’écriture, du jeu d’acteur et de la réalisation de films. Chaque résident avait la possibilité d’explorer l’endroit qui l’intéressait le plus.
Lorsqu’ils sont arrivés sur le plateau, les résidents étaient familiers des principes de base d’un tournage. Ce sentiment d’authenticité a été un atout majeur : les résidents nous apprenaient en temps réel ce qu’ils vivaient au quotidien.
Le fait d’être sur place, d’élaborer et de mettre en scène avec eux, dans leur maison, a permis au scénario de s’adapter à leur vie et à leur travail.
Le scénario était déjà écrit mais les résidents et le personnel ont apporté beaucoup de nuances dans le ton, l’humour, l’absurdité et la bizarrerie du film.
Votre film montre une maison de retraite particulièrement calme et lumineuse. À travers cet espace, que vouliez-vous évoquer ?
Évidemment, le type d’établissement auquel une personne a accès renvoie à des privilèges de classe et parmi tous les endroits qui existent, beaucoup ne correspondent pas à l’environnement dans lequel vous voudriez voir vos proches.
Mais les gens ont tendance à considérer les maisons de retraite comme des lieux où on attend la mort alors qu’en réalité, il s’y passe énormément de choses.
La plupart des films américains autour du vieillissement sont des récits de déclin : le drame du film porte sur la façon dont la personne s’étiole, disparaît. Quand j’étais aide-soignante, j’ai été frappée par la continuité qui résistait chez les personnes que j’assistais, malgré l’évolution de leur mémoire et de leur mobilité.
Toutes trouvaient le chemin pour s’exprimer et faire entendre leurs désirs : plutôt que la perte de soi, j’ai voulu dépeindre la force de ces transitions. Le récit du déclin met à mal l’idée que les personnes âgées sont toujours des adultes. J’avais à cœur de porter un autre regard sur ce genre d’établissement.
L’enfance se manifeste facilement chez Ruth. Était-ce un parallèle sur lequel vous vouliez travailler ?
Je pense que chacun d’entre nous, quel que soit son âge, peut accéder à tous les âges qu’il a connus. Chez les personnes âgées, il y a souvent moins d’inhibitions, ce qui permet d’entrer plus facilement au contact de ce moi enfant.
Quand j’étais aide-soignante, j’ai remarqué que les personnes que j’assistais avaient un sens du jeu très enfantin et que ce n’était pas nécessairement un symptôme de leur démence. Kathleen et moi avons voulu montrer Ruth comme une enfant, non pas à travers des flashbacks, mais dans le moment présent.
À feu doux n’est pas un film à intrigue, mais j’ai pensé au rythme du « coming of age movie » pour sa trame, notamment lorsque Ruth danse avec son fils comme au bal de promo ou quand elle est dans la piscine et sous la douche- les coming of age movies ont souvent ces moments de révélation à soi-même dans l’eau.
Ruth est très attachée aux soignants qui s’occupent d’elle. Que vouliez-vous montrer à travers ces relations ?
Malheureusement, aux États-Unis, le travail de soignant est largement sous-estimé, tant en termes de rémunération que de perception. Les discriminations raciales et de genre y sont pour quelque chose : les aides-soignants américains sont majoritairement des femmes racisées.
L’intelligence émotionnelle et sociale requise par le métier du soin est extraordinaire : c’est un travail d’une grande précision, qui rend la vie possible à tous.
Je voulais honorer les compétences des soignants et montrer les nuances de ces relations : on peut prendre soin de quelqu’un et, d’une certaine manière, être soigné par cette personne à un autre endroit - il y a une infinité de nuances émotionnelles et de sentiments entre deux personnes.
Si j’ai choisi de terminer le film sur la scène où Ruth se fait habiller, c’est que la réalité de sa vie future se joue plus du côté du personnel soignant que de son fils. Je voulais que le film soit honnête : l’intimité entre elle et les soignants devient, d’une certaine façon, plus importante que celle qui existe entre elle et son fils.
Ruth semble avoir plus de souvenirs de son enfance et de sa vie de femme que de sa place de mère. Pourquoi avoir fait ce choix ?
D’abord, il y a le fait que chez les personnes atteintes de démence, la mémoire à long terme est souvent plus intacte que la mémoire à court terme.
Les personnes se souviennent donc de leur enfance, de leur adolescence et du début de leur vingtaine avec des détails beaucoup plus précis que d’autres moments de leur vie, pourtant plus proches dans le temps.
J’ai travaillé pour une femme de 87 ans avec qui, pendant des heures, je parlais de ses expériences d’adolescente comme si elles venaient de les vivre.
La mémoire de Ruth est sur cette même échelle temporelle. Ensuite, la mutation démographique profonde des Etats-Unis et le vieillissement croissant de la population m’interroge beaucoup.
La génération de féministes qui a ouvert la voie à la mienne, ces vagues de femmes qui ont vécu les révolutions des années 1970 sont toutes des adultes d’un certain âge maintenant. Pour écrire le personnage de Ruth, je me suis mise à penser à ces femmes qui se sont battues avec tant d’acharnement pour leur indépendance, leur pouvoir et leur autonomie.
Comment vivent-elles aujourd’hui si elles ont perdu une partie de cette autonomie ? Qui prend soin de cette génération qui a rendu ma vie possible ? J’ai imaginé Ruth quand elle avait 20 ans : peut-être qu’elle ne s’imaginait pas mère, peut-être que l’idée de le devenir avait changé à la trentaine.
Serait-elle surprise de découvrir qu’elle avait fait ce choix ? Je voulais que sa mémoire puisse être traversée par ces questions.
Votre film propose un autre récit de la vieillesse. Que souhaiteriez-vous que les spectateurs en retiennent ?
J’aimerais que le public quitte la salle avec une vision différente du rôle d’aidant, qu’il prenne conscience de sa valeur et de la façon dont ces personnes nous accompagnent.
Nous avons tous fait l’expérience d’être pris en charge à un moment de nos vies et il y a de fortes chances pour que la plupart d’entre nous deviennent aidants à leur tour. Je voudrais que le public sente ce lien qui rend nos vies possibles.
J’espère aussi que certains sortiront de la salle plus liés à leur propre incarnation et avec ce que signifie vieillir.
Nous avons trop tendance à considérer les personnes âgées comme des versions diminuées de nous-mêmes. J’aimerais que les plus jeunes se sentent liés à Ruth et reconnaissent quelque chose d’eux en elle, qu’ils voient la continuité de sa vie.
À feu doux est né d’expériences à la fois personnelles et professionnelles. La première inspiration vient de la relation avec ma grand-mère qui, alors que j’étais adolescente, s’est retrouvée atteinte de démence.
Alors qu’elle avait été éditrice de poésie et que son identité s’exprimait beaucoup à travers le langage, elle a cessé de parler. Lorsque cela s’est produit, sous le coup du trouble et du chagrin, ma famille s’est mise à parler d’elle comme si elle n’était plus là. Cette manière de parler de quelqu’un qui perd la mémoire est extrêmement courante.
Pourtant, quand je lui rendais visite, je la trouvais très expressive sur le plan physique. Elle se balançait, elle tapait des rythmes avec ses mains : il me semblait clair que, même si sa cognition était modifiée, cette autre partie d’elle-même s’exprimait.
Le fossé entre cette personne qui était bien là, juste d’une manière différente, et la façon dont le langage la décrivait est une idée qui m’a longtemps hantée.
Quelle est l’expérience professionnelle qui est venue compléter ce souvenir ?
Dix ans plus tard, alors que j’enchaînais les boulots d’assistante sur des tournages à New York, j’ai eu l’impression d’en avoir fait le tour.
J’ai alors arrêté la production, et ai commencé à travailler en tant qu’assistante pour un sculpteur atteint de démence, puis pendant plus de trois ans, pour d’autres artistes new yorkais en proie à des troubles de la mémoire.
Ce travail a changé tout ce que je pensais savoir sur le vieillissement et le soin, en particulier sur l’identité liée à l’âge. J’avais une vingtaine d’années à l’époque et les personnes que j’assistais avaient beau être octogénaires et nonagénaires, elles s’identifiaient à moi comme à leur véritable pair, non pas comme à quelqu’un de plus jeune.
Cette perception malléable de l’âge et de l’identité est ce qui a conduit aux prémices de À feu doux : j’avais envie de faire de Ruth un personnage à la fois sans âge et de tous les âges, et d’explorer toutes ses itérations possibles.
Une partie du film a été réalisée avec les résidents d’un établissement. Comment est né ce processus ?
Après avoir travaillé comme aide-soignante, j’ai réalisé un court-métrage (Home Exercises) en collaboration avec un groupe de personnes âgées. J’ai remarqué qu’elles étaient très intéressées par la réalisation -elles ne se contentaient pas de jouer dans le film, elles voulaient comprendre la cinématographie, le son, la production.
Avec mon équipe, nous avons fini par leur apprendre en quoi consistait la réalisation d’un film. J’ai compris que si je voulais vraiment faire un film contre l’âgisme, mes méthodes devaient refléter l’éthique du projet.
La société américaine pense à tort que les personnes dépendantes de soins n’ont plus rien à apporter, j’ai donc voulu intégrer leurs talents à la réalisation du film.
Quelle forme a pris cette collaboration ?
Trouver la bonne communauté a pris un certain temps : nous avions besoin d’un endroit sensible à l’idée d’apprentissage et capable d’accueillir la production d’un long-métrage.
Villa Gardens a été fondée dans les années 1920 par Ethel Percy Andrus, la toute première femme proviseure de Californie et fondatrice de l’AARP (American Association of Retired Persons).
Aujourd’hui, la communauté reste formée d’anciens professionnels de l’éducation. Il y règne une vraie culture de l’apprentissage : le fait que les résidents veuillent découvrir comment faire des films était nécessaire à la réalisation du projet.
Nous avons organisé un atelier de cinq semaines autour de l’écriture, du jeu d’acteur et de la réalisation de films. Chaque résident avait la possibilité d’explorer l’endroit qui l’intéressait le plus.
Lorsqu’ils sont arrivés sur le plateau, les résidents étaient familiers des principes de base d’un tournage. Ce sentiment d’authenticité a été un atout majeur : les résidents nous apprenaient en temps réel ce qu’ils vivaient au quotidien.
Le fait d’être sur place, d’élaborer et de mettre en scène avec eux, dans leur maison, a permis au scénario de s’adapter à leur vie et à leur travail.
Le scénario était déjà écrit mais les résidents et le personnel ont apporté beaucoup de nuances dans le ton, l’humour, l’absurdité et la bizarrerie du film.
Votre film montre une maison de retraite particulièrement calme et lumineuse. À travers cet espace, que vouliez-vous évoquer ?
Évidemment, le type d’établissement auquel une personne a accès renvoie à des privilèges de classe et parmi tous les endroits qui existent, beaucoup ne correspondent pas à l’environnement dans lequel vous voudriez voir vos proches.
Mais les gens ont tendance à considérer les maisons de retraite comme des lieux où on attend la mort alors qu’en réalité, il s’y passe énormément de choses.
La plupart des films américains autour du vieillissement sont des récits de déclin : le drame du film porte sur la façon dont la personne s’étiole, disparaît. Quand j’étais aide-soignante, j’ai été frappée par la continuité qui résistait chez les personnes que j’assistais, malgré l’évolution de leur mémoire et de leur mobilité.
Toutes trouvaient le chemin pour s’exprimer et faire entendre leurs désirs : plutôt que la perte de soi, j’ai voulu dépeindre la force de ces transitions. Le récit du déclin met à mal l’idée que les personnes âgées sont toujours des adultes. J’avais à cœur de porter un autre regard sur ce genre d’établissement.
L’enfance se manifeste facilement chez Ruth. Était-ce un parallèle sur lequel vous vouliez travailler ?
Je pense que chacun d’entre nous, quel que soit son âge, peut accéder à tous les âges qu’il a connus. Chez les personnes âgées, il y a souvent moins d’inhibitions, ce qui permet d’entrer plus facilement au contact de ce moi enfant.
Quand j’étais aide-soignante, j’ai remarqué que les personnes que j’assistais avaient un sens du jeu très enfantin et que ce n’était pas nécessairement un symptôme de leur démence. Kathleen et moi avons voulu montrer Ruth comme une enfant, non pas à travers des flashbacks, mais dans le moment présent.
À feu doux n’est pas un film à intrigue, mais j’ai pensé au rythme du « coming of age movie » pour sa trame, notamment lorsque Ruth danse avec son fils comme au bal de promo ou quand elle est dans la piscine et sous la douche- les coming of age movies ont souvent ces moments de révélation à soi-même dans l’eau.
Ruth est très attachée aux soignants qui s’occupent d’elle. Que vouliez-vous montrer à travers ces relations ?
Malheureusement, aux États-Unis, le travail de soignant est largement sous-estimé, tant en termes de rémunération que de perception. Les discriminations raciales et de genre y sont pour quelque chose : les aides-soignants américains sont majoritairement des femmes racisées.
L’intelligence émotionnelle et sociale requise par le métier du soin est extraordinaire : c’est un travail d’une grande précision, qui rend la vie possible à tous.
Je voulais honorer les compétences des soignants et montrer les nuances de ces relations : on peut prendre soin de quelqu’un et, d’une certaine manière, être soigné par cette personne à un autre endroit - il y a une infinité de nuances émotionnelles et de sentiments entre deux personnes.
Si j’ai choisi de terminer le film sur la scène où Ruth se fait habiller, c’est que la réalité de sa vie future se joue plus du côté du personnel soignant que de son fils. Je voulais que le film soit honnête : l’intimité entre elle et les soignants devient, d’une certaine façon, plus importante que celle qui existe entre elle et son fils.
Ruth semble avoir plus de souvenirs de son enfance et de sa vie de femme que de sa place de mère. Pourquoi avoir fait ce choix ?
D’abord, il y a le fait que chez les personnes atteintes de démence, la mémoire à long terme est souvent plus intacte que la mémoire à court terme.
Les personnes se souviennent donc de leur enfance, de leur adolescence et du début de leur vingtaine avec des détails beaucoup plus précis que d’autres moments de leur vie, pourtant plus proches dans le temps.
J’ai travaillé pour une femme de 87 ans avec qui, pendant des heures, je parlais de ses expériences d’adolescente comme si elles venaient de les vivre.
La mémoire de Ruth est sur cette même échelle temporelle. Ensuite, la mutation démographique profonde des Etats-Unis et le vieillissement croissant de la population m’interroge beaucoup.
La génération de féministes qui a ouvert la voie à la mienne, ces vagues de femmes qui ont vécu les révolutions des années 1970 sont toutes des adultes d’un certain âge maintenant. Pour écrire le personnage de Ruth, je me suis mise à penser à ces femmes qui se sont battues avec tant d’acharnement pour leur indépendance, leur pouvoir et leur autonomie.
Comment vivent-elles aujourd’hui si elles ont perdu une partie de cette autonomie ? Qui prend soin de cette génération qui a rendu ma vie possible ? J’ai imaginé Ruth quand elle avait 20 ans : peut-être qu’elle ne s’imaginait pas mère, peut-être que l’idée de le devenir avait changé à la trentaine.
Serait-elle surprise de découvrir qu’elle avait fait ce choix ? Je voulais que sa mémoire puisse être traversée par ces questions.
Votre film propose un autre récit de la vieillesse. Que souhaiteriez-vous que les spectateurs en retiennent ?
J’aimerais que le public quitte la salle avec une vision différente du rôle d’aidant, qu’il prenne conscience de sa valeur et de la façon dont ces personnes nous accompagnent.
Nous avons tous fait l’expérience d’être pris en charge à un moment de nos vies et il y a de fortes chances pour que la plupart d’entre nous deviennent aidants à leur tour. Je voudrais que le public sente ce lien qui rend nos vies possibles.
J’espère aussi que certains sortiront de la salle plus liés à leur propre incarnation et avec ce que signifie vieillir.
Nous avons trop tendance à considérer les personnes âgées comme des versions diminuées de nous-mêmes. J’aimerais que les plus jeunes se sentent liés à Ruth et reconnaissent quelque chose d’eux en elle, qu’ils voient la continuité de sa vie.