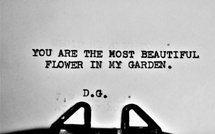1. Aidants familiaux & Vie quotidienne
Le lien familial est prédominant dans le couple aidant/aidé
• Il apparaît plus souvent de type ascendant (dans 60% des cas) qu’équivalent générationnel ou descendant. 39% des aidants s’occupent de leur père ou de leur mère (58% chez les 35-54 ans et 54% chez les 55-75 ans), 10% de leur beau-père ou de leur belle-mère. Un tiers des aidants de plus de 75 ans s’occupe de leur compagnon/conjoint(e).
• Dans ce contexte, les motivations initiales de l’aide sont principalement fondées sur les liens affectifs (75%), la conformité avec les valeurs de vie (55%) et le sentiment de devoir le faire (48%). 10% avouent en avoir tiré une satisfaction personnelle.
Les aidants sont extrêmement impliqués dans leur rôle
• Lorsqu’ils ne vivent pas déjà avec la personne qu’ils aident, dans la quasi-totalité des cas (89%), ils s’en occupent tous les jours ou plusieurs fois par semaine (seulement un aidant sur dix s’occupe de la personne aidée qu’une fois par semaine).
• En moyenne, les aidants apportent quatre grands types d’aides, parmi lesquels figurent prioritairement le soutien moral (96%), la surveillance (88%), l’aide pour les activités domestiques (68%) et l’aide pour la gestion financière et administrative (60%).
• 80% des personnes interrogées expliquent qu’elles acceptent que leur proche dépendant les contacte à n’importe quel moment de la journée. Pour la majorité d’entre-eux, leur mission apparaît difficilement « délégable » : 54% préfèrent s’occuper eux-mêmes de la coordination et de l’organisation des soins de la personne aidée.
• Alors que 73% disposent de solutions de recours, ils sont seulement 37% à se déclarer prêts à y faire appel. Lorsque c’est le cas, 42% en éprouvent du soulagement et 27% de la satisfaction.
Un impact réel, mais contrasté
• 90% des aidants ont le sentiment d’arriver à faire face à leur situation tout en appréhendant ce sentiment de manière contrastée. Dans ce contexte, 23% d’entre-eux ne citent aucune répercussion négative tandis que 30% en citent au moins cinq.
• En moyenne, les répercussions négatives les plus marquées touchent aux loisirs (70%), à la forme physique (57%) et à la situation financière (56%). A noter que l’aide familiale semble aussi avoir un impact positif sur la relation avec la personne qu’ils aident (84%), sur leur vie de famille (65%), sur leur vie conjugale (57%) et sur les relations avec leurs amis (57%).
• Enfin, une minorité a déjà mis entre parenthèses sa santé afin d’assurer son rôle d’aidant : 16% ont, en effet, été amenés à reculer un soin médical, une consultation ou une hospitalisation en raison de la dépendance de leur proche.
• La problématique centrale demeure la gestion du temps : le fait de devoir le gérer différemment (59%) et le souci permanent de l’autre (33%) apparaissent comme les deux répercussions les plus significatives.
Des attentes fortes vis-à-vis des pouvoirs publics
• 71% des aidants s’estiment insuffisamment aidés et considérés de la part des pouvoirs publics.
• Au titre des actions prioritaires à mettre en oeuvre, il faut sans doute souligner le caractère altruiste de leurs attentes : 73% des aidants se déclarent favorables à une meilleure prise en charge des personnes malades ou dépendantes sans entourage contre 57% sur des actions visant à préserver leur propre santé (plusieurs items possibles).
Le lien familial est prédominant dans le couple aidant/aidé
• Il apparaît plus souvent de type ascendant (dans 60% des cas) qu’équivalent générationnel ou descendant. 39% des aidants s’occupent de leur père ou de leur mère (58% chez les 35-54 ans et 54% chez les 55-75 ans), 10% de leur beau-père ou de leur belle-mère. Un tiers des aidants de plus de 75 ans s’occupe de leur compagnon/conjoint(e).
• Dans ce contexte, les motivations initiales de l’aide sont principalement fondées sur les liens affectifs (75%), la conformité avec les valeurs de vie (55%) et le sentiment de devoir le faire (48%). 10% avouent en avoir tiré une satisfaction personnelle.
Les aidants sont extrêmement impliqués dans leur rôle
• Lorsqu’ils ne vivent pas déjà avec la personne qu’ils aident, dans la quasi-totalité des cas (89%), ils s’en occupent tous les jours ou plusieurs fois par semaine (seulement un aidant sur dix s’occupe de la personne aidée qu’une fois par semaine).
• En moyenne, les aidants apportent quatre grands types d’aides, parmi lesquels figurent prioritairement le soutien moral (96%), la surveillance (88%), l’aide pour les activités domestiques (68%) et l’aide pour la gestion financière et administrative (60%).
• 80% des personnes interrogées expliquent qu’elles acceptent que leur proche dépendant les contacte à n’importe quel moment de la journée. Pour la majorité d’entre-eux, leur mission apparaît difficilement « délégable » : 54% préfèrent s’occuper eux-mêmes de la coordination et de l’organisation des soins de la personne aidée.
• Alors que 73% disposent de solutions de recours, ils sont seulement 37% à se déclarer prêts à y faire appel. Lorsque c’est le cas, 42% en éprouvent du soulagement et 27% de la satisfaction.
Un impact réel, mais contrasté
• 90% des aidants ont le sentiment d’arriver à faire face à leur situation tout en appréhendant ce sentiment de manière contrastée. Dans ce contexte, 23% d’entre-eux ne citent aucune répercussion négative tandis que 30% en citent au moins cinq.
• En moyenne, les répercussions négatives les plus marquées touchent aux loisirs (70%), à la forme physique (57%) et à la situation financière (56%). A noter que l’aide familiale semble aussi avoir un impact positif sur la relation avec la personne qu’ils aident (84%), sur leur vie de famille (65%), sur leur vie conjugale (57%) et sur les relations avec leurs amis (57%).
• Enfin, une minorité a déjà mis entre parenthèses sa santé afin d’assurer son rôle d’aidant : 16% ont, en effet, été amenés à reculer un soin médical, une consultation ou une hospitalisation en raison de la dépendance de leur proche.
• La problématique centrale demeure la gestion du temps : le fait de devoir le gérer différemment (59%) et le souci permanent de l’autre (33%) apparaissent comme les deux répercussions les plus significatives.
Des attentes fortes vis-à-vis des pouvoirs publics
• 71% des aidants s’estiment insuffisamment aidés et considérés de la part des pouvoirs publics.
• Au titre des actions prioritaires à mettre en oeuvre, il faut sans doute souligner le caractère altruiste de leurs attentes : 73% des aidants se déclarent favorables à une meilleure prise en charge des personnes malades ou dépendantes sans entourage contre 57% sur des actions visant à préserver leur propre santé (plusieurs items possibles).

2. Aidants familiaux & Professionnels de santé
L’aidant s’estime devenir progressivement un partenaire incontournable, reconnu par les professionnels de santé
• 70% des aidants estiment que les professionnels de santé les considèrent comme de véritables partenaires de soin.
• Les résultats des sondages montrent que c’est en majorité l’aidant qui prend les décisions concernant la santé du proche aidé (38% des décisions).
• Au-delà de l’aide aux soins, de l’aide à la prise de médicaments, la préparation des repas, l’aidant doit répondre aux questions de l’aidé sur sa maladie et son évolution (83% des aidants disent discuter de ces sujets avec les personnes malades).
Les relations sont appréhendées de façon plutôt positive
• 71% des aidants estiment que ces mêmes professionnels apportent en général une bonne réponse à leurs difficultés.
• Les points d’accord portent principalement sur : le fait que le professionnel de santé leur explique la situation de la personne aidée : 72% ; le fait que ce professionnel s’assure de pouvoir les contacter facilement : 70% ; et le fait d’être impliqué dans les soins et le suivi thérapeutique : 52%
• Des attentes fortes subsistent quant au fait que les professionnels leur apportent des conseils pour se préserver (59%) et fassent plus attention à leur propre santé (67%).
Des difficultés relationnelles demeurent
• Les aidants soulignent notamment le fait que les professionnels de santé visitent la personne aidée en leur absence (17%), et qu’ils leur parlent directement plutôt qu’à la personne aidée (16%). De plus, ils déplorent également que les professionnels de santé aient du mal à accepter que l’aidant prenne différents avis médicaux.
• Par ailleurs, 11% des aidants soulignent que les professionnels de santé ne s’aperçoivent pas qu’ils sont en train de s’épuiser.
Une approche contrastée des dispositifs de formation
• Si près de 10% des aidants ont déjà participé à une formation dédiée aux aidants, 45% ne sont pas intéressés par ce type de démarche : parmi eux, 65% n’en voient pas l’utilité et 27% estiment ne pas en avoir le temps.
• Sur les 55% d’aidants intéressés pour participer à une formation, l’objectif majoritaire est l’amélioration de la qualité de vie de la personne aidée (42%) et l’acquisition des bons gestes pour éviter de nuire (32 %).
• 75% des aidants intéressés militent pour des formations courtes et régulières (75%) plutôt que longues et à fréquence plus espacée. La présence du formateur est plébiscitée (83%) au détriment de dispositifs à distance (9%).
3. Aidants familiaux & Vie professionnelle
Une conciliation plutôt bien vécue
• La grande majorité des aidants (90%) dit réussir à concilier vie familiale et activité professionnelle et indique même que le fait de s’occuper d’une personne malade a des répercussions positives sur leur vie professionnelle. Dans ce contexte, seulement 3% d’entre-eux ont dû arrêter de travailler en raison de la dépendance de leur proche.
• 72% en ont parlé sur leur lieu de travail, principalement aux collègues (68%), puis aux supérieurs hiérarchiques directs (38%) et beaucoup moins au médecin du travail (14%).
• Les difficultés rencontrées tiennent principalement au manque de temps (39%), au stress engendré (22%) et à la fatigue (19%).
Une prise en compte mesurée au sein du monde économique
• 58% des aidants ont le sentiment d’être suffisamment pris en compte en tant qu’aidant par leur supérieur ou leur Direction. D’ailleurs près de 52% ne souhaitent pas l’être davantage.
• Les soutiens semblent plutôt importants, émanant principalement des collègues (77%), mais aussi des supérieurs hiérarchiques (63%).
• S’agissant des actions menées en faveur des aidants au travail, les aidants soulignent majoritairement l’implication des associations de patients (59%) puis, loin derrière, des pouvoirs publics (29%) et des organisations syndicales (22%).
Un impact significatif
• Si 74% des aidants déclarent ne pas avoir dû s’absenter du fait de leur situation durant les 12 derniers mois, pour les 26% restant, le nombre moyen de jours de congés (arrêt maladie, congé sans solde…) s’établit à 16 jours. Il faut toutefois noter que près de 30% d’entre-eux ignorent les congés auxquels ils pourraient prétendre (ex. congé de soutien familial).
• 44% des aidants ont eu recours à au moins une forme d’aménagement au cours de leur vie professionnelle : principalement la flexibilité des horaires (30%) et le temps partiel (12%), loin devant le télétravail (5%)
• 15% des aidants estiment par ailleurs avoir été pénalisés dans leur évolution professionnelle, soit en se voyant refuser une promotion (9%), soit en devant la refuser de leur propre initiative (11%). Au total, le manque à gagner annuel lié à leur situation d’aidant est estimé à environ 20% de leurs revenus.
Des attentes fortes liées à des modes d’aménagement qui favorisent le maintien de la dynamique professionnelle
• 64% des aidants souhaiteraient bénéficier d’un aménagement de leurs horaires ou lieu de travail afin d’avoir plus de temps pour s’occuper de leur proche.
• En termes d’attentes, elles convergent prioritairement vers des solutions privilégiant une dynamique professionnelle : temps partiel mieux rémunéré (41%) et aménagement des horaires de travail (37%) plutôt que congé temporaire (29%) ou retraite anticipée (26%).
• Par ailleurs, les aidants semblent favoriser des formes de maintien sur le lieu de travail, puisque les possibilités de télétravail sont faiblement évoquées (23%).
Méthodologie
Ce panel représentatif initial de 1.023 personnes a été constitué du 25 janvier au 5 juillet 2008 via un recrutement au sein d’une population générale de 28.205 personnes (28 vagues omnibus représentatives de 1.000 personnes). Il a donné lieu à des vagues de sondage omnibus successives permettant d’interroger 600 à 850 aidants (selon les vagues).
L’aidant s’estime devenir progressivement un partenaire incontournable, reconnu par les professionnels de santé
• 70% des aidants estiment que les professionnels de santé les considèrent comme de véritables partenaires de soin.
• Les résultats des sondages montrent que c’est en majorité l’aidant qui prend les décisions concernant la santé du proche aidé (38% des décisions).
• Au-delà de l’aide aux soins, de l’aide à la prise de médicaments, la préparation des repas, l’aidant doit répondre aux questions de l’aidé sur sa maladie et son évolution (83% des aidants disent discuter de ces sujets avec les personnes malades).
Les relations sont appréhendées de façon plutôt positive
• 71% des aidants estiment que ces mêmes professionnels apportent en général une bonne réponse à leurs difficultés.
• Les points d’accord portent principalement sur : le fait que le professionnel de santé leur explique la situation de la personne aidée : 72% ; le fait que ce professionnel s’assure de pouvoir les contacter facilement : 70% ; et le fait d’être impliqué dans les soins et le suivi thérapeutique : 52%
• Des attentes fortes subsistent quant au fait que les professionnels leur apportent des conseils pour se préserver (59%) et fassent plus attention à leur propre santé (67%).
Des difficultés relationnelles demeurent
• Les aidants soulignent notamment le fait que les professionnels de santé visitent la personne aidée en leur absence (17%), et qu’ils leur parlent directement plutôt qu’à la personne aidée (16%). De plus, ils déplorent également que les professionnels de santé aient du mal à accepter que l’aidant prenne différents avis médicaux.
• Par ailleurs, 11% des aidants soulignent que les professionnels de santé ne s’aperçoivent pas qu’ils sont en train de s’épuiser.
Une approche contrastée des dispositifs de formation
• Si près de 10% des aidants ont déjà participé à une formation dédiée aux aidants, 45% ne sont pas intéressés par ce type de démarche : parmi eux, 65% n’en voient pas l’utilité et 27% estiment ne pas en avoir le temps.
• Sur les 55% d’aidants intéressés pour participer à une formation, l’objectif majoritaire est l’amélioration de la qualité de vie de la personne aidée (42%) et l’acquisition des bons gestes pour éviter de nuire (32 %).
• 75% des aidants intéressés militent pour des formations courtes et régulières (75%) plutôt que longues et à fréquence plus espacée. La présence du formateur est plébiscitée (83%) au détriment de dispositifs à distance (9%).
3. Aidants familiaux & Vie professionnelle
Une conciliation plutôt bien vécue
• La grande majorité des aidants (90%) dit réussir à concilier vie familiale et activité professionnelle et indique même que le fait de s’occuper d’une personne malade a des répercussions positives sur leur vie professionnelle. Dans ce contexte, seulement 3% d’entre-eux ont dû arrêter de travailler en raison de la dépendance de leur proche.
• 72% en ont parlé sur leur lieu de travail, principalement aux collègues (68%), puis aux supérieurs hiérarchiques directs (38%) et beaucoup moins au médecin du travail (14%).
• Les difficultés rencontrées tiennent principalement au manque de temps (39%), au stress engendré (22%) et à la fatigue (19%).
Une prise en compte mesurée au sein du monde économique
• 58% des aidants ont le sentiment d’être suffisamment pris en compte en tant qu’aidant par leur supérieur ou leur Direction. D’ailleurs près de 52% ne souhaitent pas l’être davantage.
• Les soutiens semblent plutôt importants, émanant principalement des collègues (77%), mais aussi des supérieurs hiérarchiques (63%).
• S’agissant des actions menées en faveur des aidants au travail, les aidants soulignent majoritairement l’implication des associations de patients (59%) puis, loin derrière, des pouvoirs publics (29%) et des organisations syndicales (22%).
Un impact significatif
• Si 74% des aidants déclarent ne pas avoir dû s’absenter du fait de leur situation durant les 12 derniers mois, pour les 26% restant, le nombre moyen de jours de congés (arrêt maladie, congé sans solde…) s’établit à 16 jours. Il faut toutefois noter que près de 30% d’entre-eux ignorent les congés auxquels ils pourraient prétendre (ex. congé de soutien familial).
• 44% des aidants ont eu recours à au moins une forme d’aménagement au cours de leur vie professionnelle : principalement la flexibilité des horaires (30%) et le temps partiel (12%), loin devant le télétravail (5%)
• 15% des aidants estiment par ailleurs avoir été pénalisés dans leur évolution professionnelle, soit en se voyant refuser une promotion (9%), soit en devant la refuser de leur propre initiative (11%). Au total, le manque à gagner annuel lié à leur situation d’aidant est estimé à environ 20% de leurs revenus.
Des attentes fortes liées à des modes d’aménagement qui favorisent le maintien de la dynamique professionnelle
• 64% des aidants souhaiteraient bénéficier d’un aménagement de leurs horaires ou lieu de travail afin d’avoir plus de temps pour s’occuper de leur proche.
• En termes d’attentes, elles convergent prioritairement vers des solutions privilégiant une dynamique professionnelle : temps partiel mieux rémunéré (41%) et aménagement des horaires de travail (37%) plutôt que congé temporaire (29%) ou retraite anticipée (26%).
• Par ailleurs, les aidants semblent favoriser des formes de maintien sur le lieu de travail, puisque les possibilités de télétravail sont faiblement évoquées (23%).
Méthodologie
Ce panel représentatif initial de 1.023 personnes a été constitué du 25 janvier au 5 juillet 2008 via un recrutement au sein d’une population générale de 28.205 personnes (28 vagues omnibus représentatives de 1.000 personnes). Il a donné lieu à des vagues de sondage omnibus successives permettant d’interroger 600 à 850 aidants (selon les vagues).