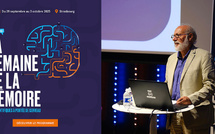Les dépenses actuelles liées directement à l’aide aux personnes fragiles et très fragiles représentent environ quinze milliards d’euros.
C’est une somme importante qui représente 1% de la richesse créée chaque année.
Elle ne recouvre cependant pas l’ensemble des charges, en particulier celles assumées par les familles. Pour être plus juste, sans doute faudrait-il doubler les sommes pour s’approcher de la réalité.
Dans les vingt prochaines années, ce chiffre va s’accroître en raison de la hausse du nombre de personnes âgées très fragilisées. À l’horizon 2020, le coût pour l’assurance-maladie de l’augmentation du nombre des personnes très fragilisées par rapport à 2003 devrait augmenter de 3 à 4,7 milliards d’euros par an*.
Attention cependant, à ne pas confondre l’augmentation –explosive- des plus de 85 ans, qui va s’accroître de 75 % dans les dix ans à venir, avec celle des personnes âgées très fragiles qui va progresser d’environ 20 %. Heureusement, le passage à la très grande fragilité est loin de toucher l’ensemble des très âgés. Ainsi, dans la tranche des plus de 80 ans, 20 % seulement des personnes se situent dans la grande fragilité.
En effet, les gains prodigieux d’espérance de vie se font au profit d’une « bonne » vie, sans croissance particulière des handicaps et difficultés. Comme toujours les représentations dramatisent les choses : vivre plus vieux ne signifie pas forcément vivre en mauvaise santé. La vie s’allonge mais la vieillesse recule.
Le développement de la grande fragilité implique deux types d’action : d’abord les investissements dans la prise en charge des personnes à travers différents services et des structures médicalisées, ou non ; ensuite, les investissements d’ordre globaux qui concernent finalement l’ensemble de la société.
Ce sont les premiers qui posent question et nécessitent un effort de financement.
Serge Guérin
Professeur à l’ESG
Vient de publier Vive les vieux !, Editions Michalon
*Rapport de la Cour des comptes consacré aux personnes âgées dépendantes, novembre 2005
C’est une somme importante qui représente 1% de la richesse créée chaque année.
Elle ne recouvre cependant pas l’ensemble des charges, en particulier celles assumées par les familles. Pour être plus juste, sans doute faudrait-il doubler les sommes pour s’approcher de la réalité.
Dans les vingt prochaines années, ce chiffre va s’accroître en raison de la hausse du nombre de personnes âgées très fragilisées. À l’horizon 2020, le coût pour l’assurance-maladie de l’augmentation du nombre des personnes très fragilisées par rapport à 2003 devrait augmenter de 3 à 4,7 milliards d’euros par an*.
Attention cependant, à ne pas confondre l’augmentation –explosive- des plus de 85 ans, qui va s’accroître de 75 % dans les dix ans à venir, avec celle des personnes âgées très fragiles qui va progresser d’environ 20 %. Heureusement, le passage à la très grande fragilité est loin de toucher l’ensemble des très âgés. Ainsi, dans la tranche des plus de 80 ans, 20 % seulement des personnes se situent dans la grande fragilité.
En effet, les gains prodigieux d’espérance de vie se font au profit d’une « bonne » vie, sans croissance particulière des handicaps et difficultés. Comme toujours les représentations dramatisent les choses : vivre plus vieux ne signifie pas forcément vivre en mauvaise santé. La vie s’allonge mais la vieillesse recule.
Le développement de la grande fragilité implique deux types d’action : d’abord les investissements dans la prise en charge des personnes à travers différents services et des structures médicalisées, ou non ; ensuite, les investissements d’ordre globaux qui concernent finalement l’ensemble de la société.
Ce sont les premiers qui posent question et nécessitent un effort de financement.
Serge Guérin
Professeur à l’ESG
Vient de publier Vive les vieux !, Editions Michalon
*Rapport de la Cour des comptes consacré aux personnes âgées dépendantes, novembre 2005