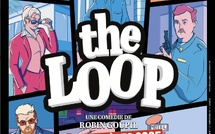Dans « Photo de famille », vous mettez quatre générations en scène –un enfant, de jeunes adultes, leurs parents et grands-parents, lesquels se montrent déterminants dans le dénouement de l’histoire.
Quel que soit l’âge qu’on a et les problématiques familiales que l’on n’a pas su résoudre, on reste tous, et jusqu’à la fin, le fils de sa mère ou le père de son enfant. Et je trouvais joli qu’aussi « mauvais père » que le personnage de Jean-Pierre Bacri ait pu être, il puisse se questionner sur la façon dont il s’est comporté en tant que fils.
Un comportement assez peu chaleureux. Cette génération, tellement portée sur l’expression, n’a manifestement pas beaucoup communiqué avec ses parents.
Après 68, beaucoup ont choisi de vivre une toute autre vie. Ils ont dû rompre avec la façon de penser de leurs aînés et, dans le même mouvement, se sont privés de discussions ou de mots qui leur étaient pourtant vitaux. Parvenus à l’âge mur, ils voient la vieillesse et la mort arriver avec le sentiment d’avoir raté quelque chose d’essentiel.
Ce qui n’empêche pas le personnage de Bacri de militer pour placer sa mère, souffrant d’un début d’Alzheimer, dans une maison de retraite…
Je dirais qu’il s’agit plus de fuite et déni que de rejet. Le père a peur de découvrir l’image de son propre vieillissement, de sa déchéance et de sa propre fin. Au-delà de son égoïsme, réel, il n’a pas le mode d’emploi. Mais il évolue, il finit par avoir envie de mieux, d’autre chose ; on sent qu’il sera bientôt près à faire amende honorable. Il avance vers un attendrissement salutaire.
Curieusement, les plus lucides de cette famille sont Solal, le fils de Gabrielle, et cette vieille dame dont l’obsession, apparemment incongrue, d’aller mourir à Saint Julien, le village où elle a vécu et régulièrement réuni ses petits-enfants, correspond simplement au désir de voir enfin réparée cette fratrie.
Exactement. Toute perdue qu’elle semble être dans le réel, elle souhaite profondément que le trio soit réuni. C’est essentiel pour elle qui a toujours œuvré dans ce sens. A partir du moment où ses trois petits enfants acceptent de l’emmener dans ce village, elle peut mourir sereinement.
Contrairement à la psy qu’incarne Chantal Lauby, Solal, l’adolescent de la famille, se montre également très objectif sur la situation de la fratrie et de la famille en général.
De même que la grand-mère s’est délestée d’un certain nombre de réflexes, lui n’est pas encore marqué par le poids des petits arrangements avec le réel. Il voit ce que les adultes ne voient pas, il dit les choses et, lorsqu’il pose une question, il attend une réponse intellectuellement acceptable. J’aime beaucoup ses confrontations avec sa mère et son grand-père ; ce n’est jamais agressif, juste sérieux.
La scène où Solal lit à l’hôpital au chevet de sa grand-mère est très émouvante.
Oui parce qu’il y a, de génération en génération, des correspondances dans cette famille qui ne sont pas attendues. Peu importe que Solal soit très jeune et son arrière-grand-mère, très vieille, qu’il lise et qu’elle dorme : le lien est là.
« Photo de famille » démarre et s’achève sur une scène d’enterrement, la première symbolisant l’éclatement de la famille, la seconde sa réconciliation, comme si chacun des membres s’était subtilement déplacé de son petit cercle…
Le film est construit comme ça. A partir d’un élément déclencheur -cette vieille dame qui veut aller mourir dans son village-, chaque personnage va enclencher chez lui et chez les autres un processus qui va leur permettre à tous de se réparer. Mais cela vient de mille endroits et de mille façons.
C’est, ainsi, pour les enfants, l’occasion de comprendre à quel point la vieille dame a été importante pour eux…
Elle a été un refuge pour le trio mais ils ne mesurent pas à quel point au début ; ils ne le comprennent qu’en se le disant. Je crois beaucoup au pouvoir de la parole, à l’importance de « se dire » les choses.
Après « Je me suis fait tout petit », votre premier long métrage, vous abordez à nouveau le thème de la famille…
La famille est un sujet qui m’intéresse beaucoup, j’ai eu envie de m’y immerger une nouvelle fois. J’ai le sentiment que nous sommes tous durablement marqués par notre histoire familiale ; elle est plus ou moins simple, plus ou moins compliquée, mais toujours étroitement liée à ce que nous sommes et aux choix que nous faisons. J’ai l’impression qu’on finit tous par y revenir, et qu’on ne s’en sort pratiquement jamais. J’avais envie réaliser un film qui raconterait comment, potentiellement, on pourrait s’en sortir…
Cette fois, il n’est plus question de famille recomposée mais d’une famille en totale décomposition et depuis longtemps. Plus personne ne se comprend, plus personne ne réussit à se parler.
Ce sont des gens qui ne se côtoient pas et qui ne s’entendent pas, au sens de s’« écouter ». Ils souffrent d’une fracture originelle qui les empêche d’être heureux et pleins d’eux-mêmes. Mais ils s’aiment, il n’y aurait pas de film sinon.
Parlons de cette fracture, tout de même assez particulière qui fait, qu’au moment de se séparer, un couple a choisi de prendre l’un, ses deux filles, et l’autre, son fils, éparpillant ainsi la fratrie.
Certains couples en rupture ont commis cette erreur dans les années soixante-dix. Dans l’histoire du film, on imagine que Mai 68 était passé par là, qu’ils étaient jeunes parents et qu’ils avaient à reconstruire un monde qu’ils venaient de faire exploser. Ils ont fait cela en pensant faire au mieux.
Je ne les juge pas : je ne crois pas qu’ils aient agi ainsi par égoïsme. Je pense qu’ils avaient vraiment l’ambition de changer les choses et pensaient sincèrement que séparer des enfants était possible. Evidemment, leur démarche était absurde -plus personne, aucune loi, n’envisagerait aujourd’hui de désagréger ainsi une fratrie, et celle du film la paie chère. Elle est profondément marquée par un sentiment d’abandon.
Quel que soit l’âge qu’on a et les problématiques familiales que l’on n’a pas su résoudre, on reste tous, et jusqu’à la fin, le fils de sa mère ou le père de son enfant. Et je trouvais joli qu’aussi « mauvais père » que le personnage de Jean-Pierre Bacri ait pu être, il puisse se questionner sur la façon dont il s’est comporté en tant que fils.
Un comportement assez peu chaleureux. Cette génération, tellement portée sur l’expression, n’a manifestement pas beaucoup communiqué avec ses parents.
Après 68, beaucoup ont choisi de vivre une toute autre vie. Ils ont dû rompre avec la façon de penser de leurs aînés et, dans le même mouvement, se sont privés de discussions ou de mots qui leur étaient pourtant vitaux. Parvenus à l’âge mur, ils voient la vieillesse et la mort arriver avec le sentiment d’avoir raté quelque chose d’essentiel.
Ce qui n’empêche pas le personnage de Bacri de militer pour placer sa mère, souffrant d’un début d’Alzheimer, dans une maison de retraite…
Je dirais qu’il s’agit plus de fuite et déni que de rejet. Le père a peur de découvrir l’image de son propre vieillissement, de sa déchéance et de sa propre fin. Au-delà de son égoïsme, réel, il n’a pas le mode d’emploi. Mais il évolue, il finit par avoir envie de mieux, d’autre chose ; on sent qu’il sera bientôt près à faire amende honorable. Il avance vers un attendrissement salutaire.
Curieusement, les plus lucides de cette famille sont Solal, le fils de Gabrielle, et cette vieille dame dont l’obsession, apparemment incongrue, d’aller mourir à Saint Julien, le village où elle a vécu et régulièrement réuni ses petits-enfants, correspond simplement au désir de voir enfin réparée cette fratrie.
Exactement. Toute perdue qu’elle semble être dans le réel, elle souhaite profondément que le trio soit réuni. C’est essentiel pour elle qui a toujours œuvré dans ce sens. A partir du moment où ses trois petits enfants acceptent de l’emmener dans ce village, elle peut mourir sereinement.
Contrairement à la psy qu’incarne Chantal Lauby, Solal, l’adolescent de la famille, se montre également très objectif sur la situation de la fratrie et de la famille en général.
De même que la grand-mère s’est délestée d’un certain nombre de réflexes, lui n’est pas encore marqué par le poids des petits arrangements avec le réel. Il voit ce que les adultes ne voient pas, il dit les choses et, lorsqu’il pose une question, il attend une réponse intellectuellement acceptable. J’aime beaucoup ses confrontations avec sa mère et son grand-père ; ce n’est jamais agressif, juste sérieux.
La scène où Solal lit à l’hôpital au chevet de sa grand-mère est très émouvante.
Oui parce qu’il y a, de génération en génération, des correspondances dans cette famille qui ne sont pas attendues. Peu importe que Solal soit très jeune et son arrière-grand-mère, très vieille, qu’il lise et qu’elle dorme : le lien est là.
« Photo de famille » démarre et s’achève sur une scène d’enterrement, la première symbolisant l’éclatement de la famille, la seconde sa réconciliation, comme si chacun des membres s’était subtilement déplacé de son petit cercle…
Le film est construit comme ça. A partir d’un élément déclencheur -cette vieille dame qui veut aller mourir dans son village-, chaque personnage va enclencher chez lui et chez les autres un processus qui va leur permettre à tous de se réparer. Mais cela vient de mille endroits et de mille façons.
C’est, ainsi, pour les enfants, l’occasion de comprendre à quel point la vieille dame a été importante pour eux…
Elle a été un refuge pour le trio mais ils ne mesurent pas à quel point au début ; ils ne le comprennent qu’en se le disant. Je crois beaucoup au pouvoir de la parole, à l’importance de « se dire » les choses.
Après « Je me suis fait tout petit », votre premier long métrage, vous abordez à nouveau le thème de la famille…
La famille est un sujet qui m’intéresse beaucoup, j’ai eu envie de m’y immerger une nouvelle fois. J’ai le sentiment que nous sommes tous durablement marqués par notre histoire familiale ; elle est plus ou moins simple, plus ou moins compliquée, mais toujours étroitement liée à ce que nous sommes et aux choix que nous faisons. J’ai l’impression qu’on finit tous par y revenir, et qu’on ne s’en sort pratiquement jamais. J’avais envie réaliser un film qui raconterait comment, potentiellement, on pourrait s’en sortir…
Cette fois, il n’est plus question de famille recomposée mais d’une famille en totale décomposition et depuis longtemps. Plus personne ne se comprend, plus personne ne réussit à se parler.
Ce sont des gens qui ne se côtoient pas et qui ne s’entendent pas, au sens de s’« écouter ». Ils souffrent d’une fracture originelle qui les empêche d’être heureux et pleins d’eux-mêmes. Mais ils s’aiment, il n’y aurait pas de film sinon.
Parlons de cette fracture, tout de même assez particulière qui fait, qu’au moment de se séparer, un couple a choisi de prendre l’un, ses deux filles, et l’autre, son fils, éparpillant ainsi la fratrie.
Certains couples en rupture ont commis cette erreur dans les années soixante-dix. Dans l’histoire du film, on imagine que Mai 68 était passé par là, qu’ils étaient jeunes parents et qu’ils avaient à reconstruire un monde qu’ils venaient de faire exploser. Ils ont fait cela en pensant faire au mieux.
Je ne les juge pas : je ne crois pas qu’ils aient agi ainsi par égoïsme. Je pense qu’ils avaient vraiment l’ambition de changer les choses et pensaient sincèrement que séparer des enfants était possible. Evidemment, leur démarche était absurde -plus personne, aucune loi, n’envisagerait aujourd’hui de désagréger ainsi une fratrie, et celle du film la paie chère. Elle est profondément marquée par un sentiment d’abandon.
Non seulement, Gabrielle, Elsa et Mao souffrent d’avoir été éloignés les uns des autres, avec la part de ressentiment qu’on peut imaginer, mais ils sont également profondément marqués par l’absence de l’autre parent.
Ils ne se sont jamais vraiment remis de cette blessure initiale. Parvenus à l’âge adulte, elle continue de les paralyser ; ils ne parviennent pas à avancer. Chacun, à sa manière, se sent tiraillé et incomplet. L’attitude du parent présent n’est pas non plus très constructive : le père (Jean-Pierre Bacri) a passé son temps à courir les filles ; la mère, psychiatre (Chantal Lauby), à se consacrer à ses patients.
C’est encore l’effet post 68 ?
Sûrement. On imagine que l’un travaillait, militait et passait beaucoup de temps à tromper tout le monde ; que la mère militait également tout en s’investissant à fond dans son travail avec ses patients. Aucun n’était vraiment disponible, tout en pensant sûrement l’être. La mère enterre l’ours en peluche de son petit garçon, le père jette le chat de ses filles à la poubelle : ils ont pour le moins des comportements curieux…
Les thèses de Françoise Dolto affirmant que les enfants étaient des personnes commençaient à s’imposer et cette génération de parents les ont prises au pied de la lettre négligeant le fait que, s’ils étaient effectivement des personnes, ils n’étaient pas encore des « grandes » personnes ! On nous racontait des choses qui n’étaient pas de notre âge, on nous laissait frayer avec des hippies passablement cinglés qui nous racontaient des choses terribles. Par exemple, j’ai cru pendant des années que le dictionnaire Petit Robert était un objet diabolique parce que lorsque j’étais petite, j’ai passé une soirée à écouter une folle me raconter l’histoire de Robert le diable…
Enterrer une peluche, donc un objet transitionnel, était sans doute alors un concept pour faire comprendre la mort à un enfant de cinq ans ; jeter un chat « écrabouillé » était une autre façon, plus pragmatique et non moins violente de le faire.
Vous êtes vous-même un enfant de cette génération. On vous sent fascinée par l’évolution de la société dans ce domaine.
Oui, c’est captivant d’observer l’intrusion des questions sociales dans la sphère de l’intime. Il y a, pour chaque génération de parents, des « choses à faire » et à « ne pas faire » avec ses enfants. Je pense que globalement, l’humanité avance -il est bon de savoir qu’on ne doit pas taper sur ses enfants ni les enfermer dans un placard !
Mais je pense aussi, que quelles que soient les recommandations de la société, et quelle que soit la nature de notre savoir pédagogique, il y a une immense partie de ce que nous transmettons à nos enfants qui nous échappe et nous échappera pour de bon. On ne sait pas forcément à quel endroit on va mal faire mais on va, forcément, mal faire ! Et ce n’est pas grave tant que l’on est capable, au moment opportun, de le reconnaître et, peut-être, d’aider à réparer.
Ils ne se sont jamais vraiment remis de cette blessure initiale. Parvenus à l’âge adulte, elle continue de les paralyser ; ils ne parviennent pas à avancer. Chacun, à sa manière, se sent tiraillé et incomplet. L’attitude du parent présent n’est pas non plus très constructive : le père (Jean-Pierre Bacri) a passé son temps à courir les filles ; la mère, psychiatre (Chantal Lauby), à se consacrer à ses patients.
C’est encore l’effet post 68 ?
Sûrement. On imagine que l’un travaillait, militait et passait beaucoup de temps à tromper tout le monde ; que la mère militait également tout en s’investissant à fond dans son travail avec ses patients. Aucun n’était vraiment disponible, tout en pensant sûrement l’être. La mère enterre l’ours en peluche de son petit garçon, le père jette le chat de ses filles à la poubelle : ils ont pour le moins des comportements curieux…
Les thèses de Françoise Dolto affirmant que les enfants étaient des personnes commençaient à s’imposer et cette génération de parents les ont prises au pied de la lettre négligeant le fait que, s’ils étaient effectivement des personnes, ils n’étaient pas encore des « grandes » personnes ! On nous racontait des choses qui n’étaient pas de notre âge, on nous laissait frayer avec des hippies passablement cinglés qui nous racontaient des choses terribles. Par exemple, j’ai cru pendant des années que le dictionnaire Petit Robert était un objet diabolique parce que lorsque j’étais petite, j’ai passé une soirée à écouter une folle me raconter l’histoire de Robert le diable…
Enterrer une peluche, donc un objet transitionnel, était sans doute alors un concept pour faire comprendre la mort à un enfant de cinq ans ; jeter un chat « écrabouillé » était une autre façon, plus pragmatique et non moins violente de le faire.
Vous êtes vous-même un enfant de cette génération. On vous sent fascinée par l’évolution de la société dans ce domaine.
Oui, c’est captivant d’observer l’intrusion des questions sociales dans la sphère de l’intime. Il y a, pour chaque génération de parents, des « choses à faire » et à « ne pas faire » avec ses enfants. Je pense que globalement, l’humanité avance -il est bon de savoir qu’on ne doit pas taper sur ses enfants ni les enfermer dans un placard !
Mais je pense aussi, que quelles que soient les recommandations de la société, et quelle que soit la nature de notre savoir pédagogique, il y a une immense partie de ce que nous transmettons à nos enfants qui nous échappe et nous échappera pour de bon. On ne sait pas forcément à quel endroit on va mal faire mais on va, forcément, mal faire ! Et ce n’est pas grave tant que l’on est capable, au moment opportun, de le reconnaître et, peut-être, d’aider à réparer.